
Début d’après-midi, ce vendredi à la marina du marin, je laisse vagabonder mon âme dans la douceur de l’hiver tropical. Je devais partir ce midi pour Pointe-à-Pitre, mais la météo en a décidé autrement. Alerte jaune sur la Guadeloupe, fortes précipitations, vents violents et grisaille annoncés pour cette fin de semaine. Le soleil matinal a d’ailleurs fait place à de gros nuages noirs. Il ne va pas tarder à tomber des cordes. Un temps propice à l’introspection et à la réflexion. L’occasion de revenir sur ces derniers mois de vadrouille, de découvertes et de rencontres. Egalement sur le processus qui m’a conduit ici, sous les tropiques. Parfois, il me semble que je n’ai quitté la Suisse qu’il y a peu, parfois j’ai le sentiment que toute la préparation du bateau et du voyage à Port Camargue remonte à une autre vie. Paradoxe.
- Alors, Arthur, ça va ? Tu t’adaptes au climat tropical ?
- Ah, mais tu te souviens que j’existe ? Ce ne sont pas nos conversations qui m’ont fatigué, en tous cas…
- Allez quoi, Arthur, fais pas la gueule, tu sais, j’ai eu plein de choses à faire, les réparations sur le bateau, recevoir les amis, écrire sur le blog, faire les lessives, tout ça…
- Mouais, bon… Et à part ça, comment c’est le grand voyage ?
- Le grand voyage ? Eh bien, c’est génial !
- Un peu court, jeune homme… Tu veux bien développer ?

Ca va sembler une évidence, mais le grand voyage, c’est d’abord partir. Je veux dire par là que ça n’a rien à voir avec le dépaysement de quelques semaines de vacances par ci, par là, histoire de casser le rythme de la vie quotidienne. C’est un changement de paradigme. Je n’ai pas décidé le lundi de partir le vendredi et vogue la galère. On le pressent sans pouvoir le définir avant d’y être réellement confronté, on se crée mentalement un univers de changement et de nouveautés en fonction de ce qu’on est et de ce qu’on vit, on essaie de penser à tout sans y parvenir, évidemment. En fait, avant d’y aller, le grand voyage, c’est surtout un grand fantasme.

On dévore les blogs et autres récits de grand voyage de ceux qui nous ont précédé, on rêve de ruptures et de lointains horizons, on se construit un nouvel univers radicalement différent de tout ce qu’on a pu vivre précédemment. En ce qui me concerne, c’était une énorme motivation, particulièrement à cause de ma situation socioprofessionnelle. Depuis un certain 27 mars 2004, ma vie s’était en quelque sorte arrêtée, tout un monde construit autour de mon handicap auditif (surdité et acouphènes) s’est écroulé en quelques minutes, réduisant à néant les années d’efforts et d’intégration sociale et professionnelle. Descente aux enfers par la face nord, comme le dit le poète musical Thiéfaine. Au fond du trou, habité d’idées sombres, déni, ressentiment, rancune et victimisation deviennent alors mon quotidien. Celles et ceux qui ont traversé un « burn-out » sauront précisément de quoi je parle. Le mien aura duré trois ans. C’est le temps qu’il m’aura fallu pour sortir du trou et revoir la lumière. Puis reconstruction, réapprivoisement de l’estime de soi, acceptation et lent processus de détachement du regard des autres. C’est ça le plus difficile, en fait. Parce que dans une société viscéralement, ataviquement enchaînée à la valeur travail et à la réussite personnelle, bien peu sont capables, si ce n’est d’empathie, du moins de compréhension face à une personne qui semble en bonne santé, mais qui en fait subit le monde qui l’entoure plus qu’il n’y participe. Et souffre (psychiquement) d’un handicap invisible ou plutôt non immédiatement perceptible, a contrario du paraplégique dans sa chaise, de l’unijambiste claudiquant ou du retardé mental au comportement décalé. Loin de moi l’idée de me plaindre, je l’affirme ici, je suis un privilégié ! Relativement à ma situation, s’entend.

Privilégié, parce que j’ai bénéficié de l’aide et d’un soutien sans faille de la part de ma famille et de quelques amis à qui je serai éternellement reconnaissant. Sans eux, sans leur présence, leur écoute, leurs encouragements et leur amour, je ne serais sans doute plus là pour en témoigner. Bref, la litanie de ce qui précède est simplement là pour fixer un cadre, un référent de compréhension et de motivation au grand saut. Après une dizaine d’année à exister sans avoir eu l’obligation de travailler pour vivre (merci les assurances sociales suisses et honte à ceux qui souhaitent les démanteler et ont d’ailleurs commencé à le faire !), j’avais besoin de retrouver une motivation à avancer, à reconstruire quelques chose pour redonner un sens à ma vie. Parce qu’une chose est certaine, vingt-cinq ans avant l’âge officiel de la retraite, vivre sans avoir besoin de bosser, contrairement à presque tout le monde, eh bien ça n’a rien de facile. A ceux qui sont persuadés du contraire, demandez à un chômeur longue durée comment il se sent, comment il se perçoit, socialement parlant, dans une communauté dont la première hiérarchie s’établit autour de l’activité professionnelle. Le fameux « Et-vous-vous-faites-quoi-dans-la-vie ? ». Contrairement à ce que prétendent les chantres du démantèlement social, souvent obsédés de rentabilité économique, l’assistanat subi et contraint n’a rien, mais alors rien de facile à vivre dans un pays comme la Suisse. Surtout si on a vécu avec la reconnaissance sociale d’un bon boulot gratifiant et correctement rémunéré.

Certains partent en long voyage par épuisement socioculturel ou refus de notre société consumériste, d’autres par curiosité ou besoin de décrocher pour un temps du rythme fou auquel on s’astreint en occident. Je suis parti en long voyage afin de me réinventer, de me recréer une vie qui ne soit pas une succession de séquences de contemplation oisive de ma simple survie organique. Inutile en Suisse (ou du moins considéré comme tel par le monde économique), parce qu’inapte à un emploi à la fois rentable et gratifiant, il me fallait retrouver une motivation à avancer, à faire quelque chose de ma vie qui ne soit pas un amalgame d’activités solitaires et d’occupations par défaut. Certains s’en contentent ; dans la durée, j’en suis incapable. Le besoin de pouvoir me dire, dans dix ans, que je n’aurais pas gaspillé les dernières belle années de ma vie avant la décrépitude, puis le cimetière, à rester observateur oisif du monde dans lequel je vis. Urgence, soudain, d’un nouveau défi d’existence.

Besoin aussi de me détacher de ce regard des autres qui finit tout de même par être pesant, derrière l’hypocrisie de façade socioculturelle. Sans parler d’une certaine culpabilité à force de voir des amis ou des connaissances se tuer à la tâche ou s’épuiser à la survie en tentant de suivre le rythme démentiel auquel l’économie ultra-libérale nous oblige. Et bon, il y avait aussi l’accomplissement d’un vieux rêve d’ado, partir à la découverte du monde sur un voilier. Privilégié, je le répète. Parce que contrairement à beaucoup d’autres, dans une telle situation, j’ai pu faire un choix. Un choix qui confine à une renaissance après toutes ces années passées à subir, expliquer, justifier ma situation sans jamais vraiment parvenir à convaincre, sauf quelques rares proches. Et j’ai reçu les moyens d’assumer ce choix. Tous les jours, j’ai une pensée émue pour mon papa qui sans doute, sur son petit nuage, veille sur moi. C’est en grande partie grâce à lui que je peux vous faire part de mes réflexions, bien installé dans mon petit paradis vélique. Le sentiment très agréable de me sentir à nouveau exister et vivre, non plus comme une pièce rapportée et inutile du grand mécano socioculturel occidental, mais comme un être humain à part entière. Vivant, donc.

J’en sais qui vont grincer des dents et être outrés par ce discours, grand bien leur fasse. Je ne juge pas leurs choix, qu’ils me laissent en paix avec les miens. Un moment donné, chacun est libre de regarder ce qu’il a dans les mains et de décider d’en faire quelque chose, ou pas. J’ai regardé, j’ai réfléchi et j’ai décidé de partir. Une fuite ? Oui, mais une fuite laboritienne dans tout ce que ce concept propose relativement à la liberté de l’individu placé dans un contexte donné. Le principe est assez simple, lorsque l’action n’est plus possible et que donc on subit une situation sans pouvoir s’en défaire, alors il relève de la survie que de prendre la fuite. Cela dit, une fois encore, je reste un privilégié. Parce que l’écrasante majorité de celles et ceux qui se trouvent peu ou prou dans ma situation ne bénéficient pas de cette liberté de choix. Et eux subissent, et eux tombent malades, et certains finissent par en mourir souvent prématurément, usés, épuisés, victimes consentantes mais inconscientes du grand cirque consumériste occidental. Je n’ai jamais rien considéré comme acquis, aujourd’hui, moins que jamais. Cela me permet de déguster chaque nouveau jour qui se lève, chaque nouvelle soirée qui s’annonce, avec les yeux grands ouverts, à défaut des oreilles.
Bien, une fois la décision prise de partir au long cours, et au-delà de l’aspect administratif à régler avant de larguer les amarres, il y a tout l’aspect humain et social. Malgré tout ce que je viens d’écrire sur mon besoin ressenti de fuir le référent dans lequel je suis né et ai évolué, partir, c’est laisser derrière soi les amis, les proches, la famille et un certain nombre d’habitudes et de petits plaisirs qui rythment une vie terrestre sédentaire. Tiens, ce soir, je m’ennuie, j’en vais aller manger un morceau chez Fanfan et papoter des derniers potins du village. Ah, et demain, on fête l’anniversaire d’un neveu, chouette, je vais passer une bonne soirée en famille. Mince, il fait vraiment un temps affreux, je vais regarder la finale de tennis ou le grand prix de F1. Envie de voir ma maman et de partager un repas avec elle, trente minutes de voiture et j’y suis.
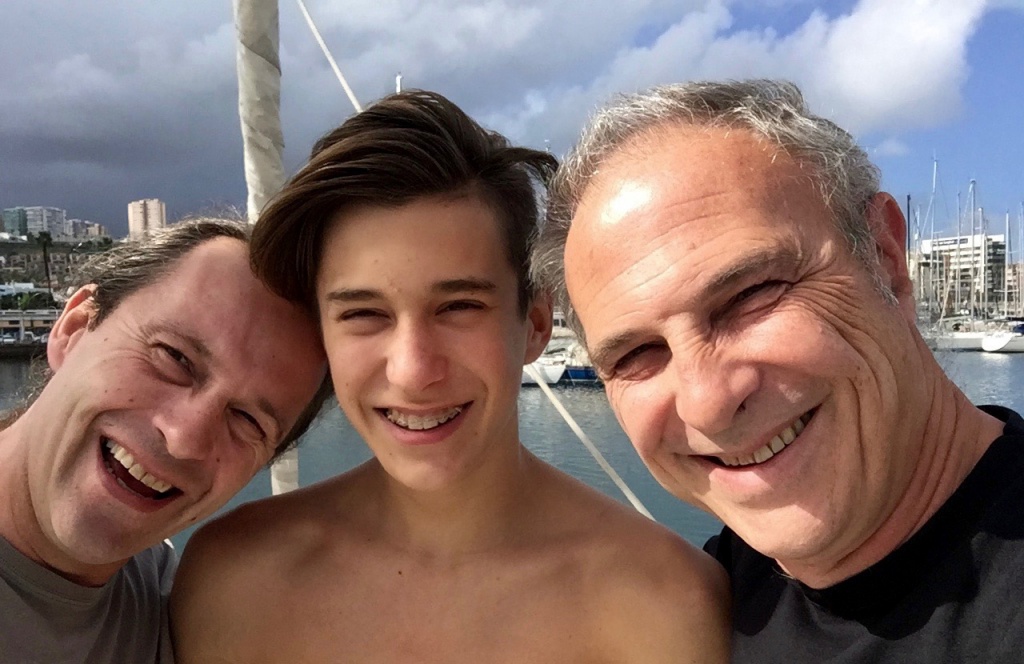
Oui, partir loin et longtemps, c’est renoncer à avoir des contacts physiques avec celles et ceux qu’on aime et dont on se sent proche, et se couper de certains centres d’intérêts. Partir, c’est aussi prendre connaissance seul et loin, sans pouvoir en discuter ou les partager, des mauvaises nouvelles comme le décès d’un ami ou la grave maladie d’un autre. Dans ces moments, on aimerait pouvoir vite rentrer, faire acte de présence, réconforter ou pleurer avec ses proches. Partir, c’est donc laisser derrière soi, une partie de ce qui constituait son cocon de vie. Finalement, depuis mon départ, c’est ça qui me manque le plus. Pas le tennis, ni la F1, mais de voir ma famille et mes amis pour partager en direct ce que je vis depuis mon départ. Certes, il y a ce blog, les SMS ou les e-mails, mais l’écrit impose une distanciation de fait. Et, ça va sans doute paraître un peu stupide ou exagérément sentimental, mais mon chat me manque ! C’est con, non ?
- Bon, c’est bien joli, tout ça. On connait maintenant tes états d’âme, tes motivations au départ et on sait que tes proches te manquent, sans parler de ton chat ! Et à part ça, la navigation, les escales, les visites, les rencontres, la découverte d’autres cultures, c’est comment ?
- Oh là, doucement mon brave, on se calme. Là, le soleil est revenu et c’est bientôt l’heure d’aller déguster un planteur sur ta terrasse couverte du Kokoarum. Veux-tu que je te rapporte une de leurs glaces maison ?

Voilà bien la première source de bonheur quand on voyage sous les tropiques. Pas les glaces du Kokoarum, enfin si, aussi, mais surtout la météo. Quand on a toujours vécu dans une région au climat continental, quel plaisir, quel bien-être que de passer un hiver sous les tropiques. Alors que mes amis sont contraints à enfiler des couches de vêtements pour ne pas claquer des dents et tenter d’éviter la grippe, les rhumes et autres angines, alors qu’ils doivent gratter les vitres de la voiture dans l’aube glacée pour aller travailler, alors que le brouillard rôde presque tout l’hiver sur le plateau suisse, je vis depuis trois mois en shorts et t-shirts, mon seul souci étant de me baigner pour me rafraîchir. D’accord, je le reconnais, j’ai quand même réussi à tomber malade, mais c’était un virus gracieusement offert par les Fab et ramené de l’hiver métropolitain. Les rares pluies torrentielles qui nous tombent dessus en quelques minutes et disparaissent tout aussi vite sont source de joie et dont je profite parfois pour me … doucher ! En clair, il fait ici en permanence le temps qu’on a parfois et rarement en Suisse quelques jours au plus fort de l’été. Ca n’a l’air de rien, mais pour le moral, ça change tout. Et j’apprécie d’autant plus les photos hivernales que certains m’envoient depuis la Suisse. Rien que pour la météo tropicale, ça valait cent fois le coup de partir.

J’imagine qu’il peut être ressenti comme sarcastique, le fait d’insister sur la météo tropicale auprès de lecteurs -trices qui affrontent les rigueurs d’un hiver continental. Mais en fait, pas tant que ça. Lors de mes précédents voyages en d’autres points du globe, j’avais pu constater à quel point le climat a une influence importante sur le mode et le rythme de vie des gens. Et des années plus tard, mon début de voyage confirme cette précédente observation. Déjà aux Canaries, j’ai été frappé par les différences qu’il y a avec l’Europe centrale ou nordique. Comme si le fait de vivre dans un climat doux atténuait les contraintes de la vie ordinaire. Et plus on descend vers le chaud, plus les gens sont débonnaires, relax et insouciants. Je me suis fait à maintes reprise la réflexion, en rigolant, que certaines de mes connaissances deviendraient instantanément folles face à la nonchalance des gens du sud. Lorsque je me suis trouvé en panne de pilote automatique au Cap Vert, j’ai approché le spécialiste local afin qu’il vienne voir le problème et pose un diagnostic. Le gars me dit, ok, pas de problème, je passe vers 15h, cet après-midi. En bon Suisse respectueux des usages et des rendez-vous donnés, je poireaute donc jusqu’à la nuit tombée sans voir arriver le gars en question, lequel débarque le lendemain vers 11h, hilare, me disant qu’il a eu un léger contretemps ! Inutile de le prendre mal, ou comme une marque d’irrespect, c’est comme ça que ça fonctionne et honnêtement, quand on est un plaisancier en vacance, qui plus est dépendant des aléas de la météo marine, il faudrait être le dernier des idiots pour s’en offusquer. Choc des cultures.

A Mindelo, j’ai pourtant croisé un compatriote qui s’agaçait que le même gars à qui j’avais eu affaire ait deux petites heures de retard sur le rendez-vous initial. Quand j’ai éclaté de rire en lui racontant que j’avais attendu presque vingt-quatre heures, il est quasi tombé de son échelle. « En tous cas, avec moi, ça ne se serait pas passé comme ça, je l’aurais envoyé paître ! » Mais oui, c’est ça, petit malin, sauf qu’à part lui, il n’y a personne de compétent pour faire le boulot. Et j’ai raté le coche, j’aurais dû lui rappeler la définition de la plaisance qui est d’aller d’un endroit où on n’a rien à faire, à un autre endroit où on a encore rien à faire… Ici aussi, en Martinique, je suis sidéré de voir des plaisanciers s’énerver pour un rien, insulter les gens pour des broutilles. Outre le fait qu’on se perturbe le sytème glandulaire sans véritable raison, je ne comprends pas qu’on puisse conserver ses réflexes occidentaux et sa rigidité mentale quand on n’a rien d’autre à faire que regarder le paysage ou siroter des spécialités locales. Si t’es pressé, prends le train, l’avion ou le bus, mais laisse le bateau à ceux qui ont et prennent le temps.

Autre anecdote, ici au Marin, chez Caraïbe Gréements. Alors que j’attendais désespérément qu’une dernière pièce de fixation de mon bout-dehors veuille bien atterrir à Fort-de-France, arrive une jolie blonde d’âge mur, pardon, d’âge mûr, un peu poseuse et malheureusement trop certaine d’un pouvoir de séduction depuis longtemps éclipsé par les outrages du temps. Elle est seule sur son petit ketch et a besoin de changer deux haubans. Pendant un jour et demi, elle a littéralement vampé l’espace de travail, véritable moulin à paroles creuses, empêchant tout le monde de travailler, même le jeune stagiaire qui devait pourtant avoir d’autres fantasmes qu’une rombière en âge d’être a minima sa mère, voire sa grand-mère. Et à la première contrariété, c’est à dire l’absence momentanée du responsable établissant les factures, elle s’est emportée, gesticulant comme si sa vie était en jeu, trépignant, vitupérant contre l’amateurisme régnant dans cette entreprise de guignols. Il s’en est fallu de peu que j’aille lui expliquer ma façon de penser. C’est simple, j’ai fini par enlever mes appareils auditifs, tellement je n’en pouvais plus. A partir de ce moment-là, j’ai apprécié la scène, comme on apprécie un bon vieux film de l’époque du muet. Finalement, il y a quelques avantages à être sourd. Et j’en profite pour saluer le stoïcisme de l’équipe de CGM qui a sans doute dû en voir d’autres. Mais tout de même, le soulagement était palpable lorsqu’elle a dégagé du ponton.

- Bon, mon pote, et à part des histoires qui révèlent ton sexisme subconscient, raconte-nous un peu ce que tu vois. Parce que tu dois te gaver de découvertes et de de visites, non ?
- Eh bien ce n’est pas si simple, figure-toi, mon cher Arthur. Et j’ai déjà parlé de mes diverses visites dans d’autres billets de ce blog.
- B’en je ne vois pas ce qu’il y a de compliqué. Tu voyages donc tu dois planifier un programme soutenu de visites, j’imagine.
Oui, mais en fait non. Lorsqu’on part en vacances quelque part, pour disons une dizaine de jours, sans compter le voyage pour y aller et en revenir, le premier réflexe est bien souvent de se constituer un programme dense et organisé, afin de profiter au maximum de son séjour. Sauf, évidemment, si on ne va au soleil que pour se prélasser sur des plages et bronzer. En revanche, le rythme du grand voyage change complètement cette approche. Par rapport au vacancier, le voyageur au long cours dispose d’un présent inestimable : le temps ! En fait, je ne suis pas vraiment en vacances… J’en vois qui restent sans voix et se demandent si je ne suis pas en train de me moquer d’eux, moi, le vacancier perpétuel. Que nenni. Je vous explique.

Au début de ce billet, j’ai parlé de changement de paradigme. Je ne suis pas parti en vacances pour une longue période, j’ai radicalement changé mon mode de vie. Le fait de vivre sur un voilier a supprimé tout un tas de contraintes terrestres, mais en a ajouté d’autres, qui, bien que différentes, n’en restent pas moins des contraintes. Mais surtout, c’est tout le rythme qui a changé. Plus lent, plus fatiguant aussi quand je navigue. Je ne passe pas mon temps à cavaler dans tous les coins, non plus que de rester à ne rien faire. Le fait de partir en bateau n’a pas supprimé les problèmes liés au handicap, ils sont atténués dans certaines situations et renforcés dans d’autres. Lorsqu’on vit quelque part à terre, on prend un rythme, on fait des choses, on a des obligations, on se fait plaisir, on va voir un ciné ou une expo ou encore un concert, on invite des gens à la maison et on répond à des invitations, on va de temps en temps au restaurant, seul ou avec des amis. De ce point de vue, il n’y a que peu de différences avec la vie terrestre. Sauf qu’on voit ses proches moins souvent.

Ce qui change vraiment, comme dit plus haut, c’est le rythme de vie. Sur un voilier, tout est plus lent, on prend plus de temps pour tout, bref, on n’est pas pressé en général. L’énorme différence c’est que je vis dans une maison mobile qui me permet de changer de coin quand j’en ai envie. Un peu comme ceux qui décident de vivre dans un camping-car. Sauf que sur mon voilier, je n’ai pas de limitations de vitesse, ni de contrôles d’alcoolémie, et le risque de croiser un abruti bourré qui va me rentrer dedans est aussi élevé que celui de croiser le dahu au milieu de l’Atlantique. Contrairement à ceux qui prennent l’avion, je n’ai pas besoin de me déshabiller et passer sous un portique avant d’embarquer, je n’ai pas besoin de vider ma valise à chaque formalité douanière et je peux embarquer avec une bouteille de rhum et mon tube de dentifrice, tout en étant mal rasé, sans pour autant passer pour un suppôt de l’EI.

Pour les visites, c’est la même chose. Pas de stress, tant il parait rapidement évident qu’il est impossible de tout voir et tout visiter, sauf à vouloir s’arrêter une année à chaque endroit où l’on atterrit. A ce rythme je serais encore en Espagne, par forcément à Barcelone, mais sans doute encore en Méditerranée. L’appétence de la découverte ou la fièvre visiteuse descend rapidement, elle s’articule aussi autour de l’état d’esprit et des soucis ou contraintes du moment. Par exemple, je sais que je n’ai pas suffisamment visité et profité du Cap Vert. Outre la grande fatigue liée au fait d’avoir dû barrer en permanence entre Las Palmas et Mindelo pour cause de défaillance du pilote automatique, cette situation m’a stressé et m’a sans doute empêché de vivre pleinement mon escale capverdienne. Vu de l’extérieur, ça paraît probablement un peu stupide, et ça l’est jusqu’à un certain point, mais finalement, avec le recul, je me rends compte que je ne m’étais pas encore assez immergé dans mon grand voyage, trop tributaire des aléas et vicissitudes de la navigation hauturière. Quand je vois avec quel relatif détachement j’ai affronté les problèmes du bateau, ici en Martinique, je mesure mieux le chemin parcouru depuis le départ de Port Camargue. Je pense pouvoir dire que je suis vraiment entré dans mon nouveau rythme de vie.

Pour revenir à la découverte et aux visites, elles s’organisent selon les envies et la forme du moment, comme on le fait quand on vit à terre. Sans doute vais-je rater des choses que d’autres voient, mais je vais aussi voir et découvrir des choses que les autres ratent. Cela n’a aucune espèce d’importance, tant il est évident qu’on ne peut pas tout faire partout. L’essentiel pour moi étant de me sentir bien dans mon nouveau rythme de vie. Et c’est le cas, sans aucune hésitation. Par exemple, au moment où je vous écris, je devrais être en Guadeloupe en compagnie de mon amie Laurence, en vacances aux Antilles pour encore une dizaine de jours. Je devrais même y être depuis au moins une bonne semaine. Mais voilà, entre la météo et les retards de livraison des pièces pour réparer et équiper le bateau, le temps a filé. Je n’en suis pas malheureux, j’aurais simplement moins de temps que prévu pour passer du temps avec elle. Le programme a un peu changé, pas le plaisir de la rencontre et du partage y associé. Et le 20 mars, toujours en Guadeloupe, je vais accueillir une autre amie, qui va rester trois semaines aux Antilles. L’occasion de revisiter les Grenadines plus en détails, de profiter de la vie et de ce qu’elle nous offre. Oui, je suis définitivement un privilégié ! Au travers de tous mes questionnements, mes doutes et mes hésitations, je suis au moins sûr et certain de ça, j’ai l’immense privilège de pouvoir vivre la vie que j’ai choisie. A bientôt.

Très beau billet! Merci pour ce partage, pour ta sincérité et ta pudeur, toujours avec style😉 Je me réjouis de goûter à ton nouveau rythme de vie!😎
Lu avec beaucoup de plaisir au coin du feu de cheminée, ici en Haute-Savoie oû le printemps n’a pas tout à fait décidé de pointer son nez.
Gros becs et bons vents pour la suite 😘😀
C’est une très belle histoire que la tienne, celle d’une revanche sur la fatalité avec à la clé une résurrection réussie ou du moins porteuse d’espoir. Puisse-t-elle t’enrichir et te rendre le plus heureux des hommes, longtemps.
Le fait que tu découvres des comportements et attitudes « aux antipodes » 😉 j’exagère, à nos traits de caractère occidentaux est très intéressant et il est de bonne graine de nous le rappeler à travers un récit aussi, idyllique soit-il ou pas, que celui que tu nous adresses ce soir.
Bisous
le père de Zeus: Chronos aime le double sens de « présent » dans cette phrase:
…le voyageur au long cours dispose d’un présent inestimable : le temps !
Et ta Castafiore flottante. Au poil!
Bon vent,
Amitiés,
L
La quête ultime d’homo sapiens: le sens de la vie. Une petite planète bleue en orbite autour d’une boule de plasma montre peu de sens aux pauvres habitants de ce monde, un monde qui pousse les individus à une fuite du présent pour un avenir idéalisé. Finalement le choix que tu fais n’est pas de trouver le sens de cette vie, mais de vivre cette vie avec comme intention de capter chacun des instants et ressentir le temps passer. Ton temps en phase avec tes émotions, tes choix en adéquation avec ce que tu souhaites vivre, carpe diem mon ami.
Mon cher Oli,
Je viens de lire ce long blog qui m’a touché au point de me donner des larmes aux yeux.
Je suis heureux de ton bonheur!
Je viens de rechuter mon burn out et suis au vert dans le Var.
J’espère que malgré tout je pourrai te rejoindre comme nous en étions convenu mais ma fille aînée passe sa thèse de médecine le 22 avril à Lille et ma seconde le 4 mai à Lyon. De plus, je dois déménager mon cabinet le 29 avril pour intégrer notre nouvelle maison médicale; donc à voir. Ta présence, ton écoute ainsi que nos échanges m’ont réjouit aux Canaries et j’aimerais vraiment revivre ce bonheur avec toi.
Je t’embrasse mon cher Oli.
PS: je n’ai pas trouvé « laboritienne » dans les dicos: y a t-il un rapport avec Henri Laborit?
Merci à toutes et tous de vos messages touchants… Ca fait chaud au coeur !
Pour Joël, oui, ce « néologisme » se rapporte à Henri Laborit et plus précisément à son ouvrage de référence, « Eloge de la fuite ». 😉
Pour Lionel, heureusement, ma Castafiore ne chante pas ! 😅😂
heeeey Oli j’ai beau avoir une bonne place de planqué mais quand je te lis je remets en question le bien fondé de travailler 😉 prochaines vacs je te rejoins 😉